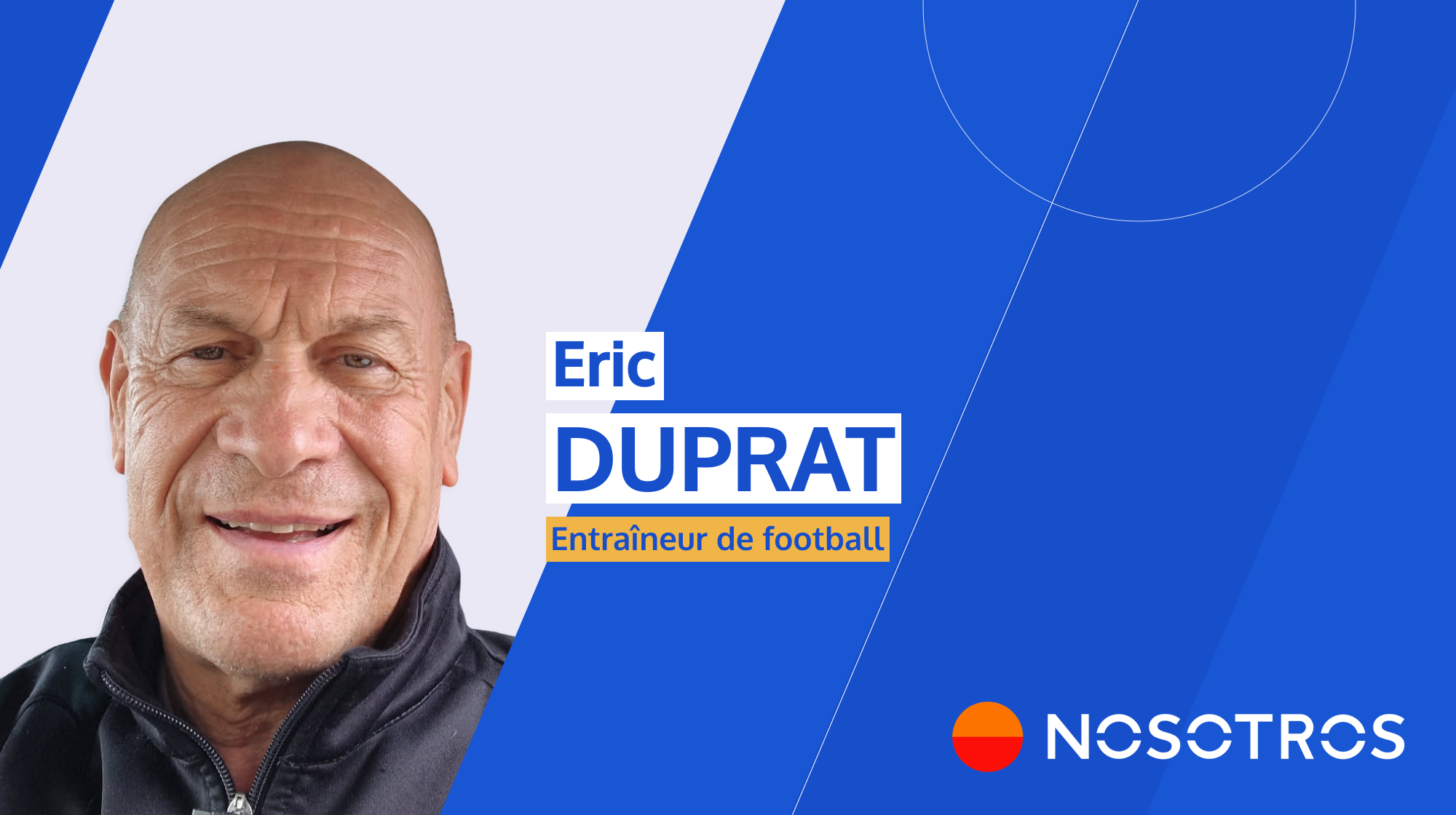
Entraineur de football, professeur agrégé d’EPS et docteur en STAPS, Eric Duprat nous propose un éclairage sur son parcours, son rapport au football, l’importance des apports théoriques et leur rapport avec la pratique.
Chaque dimanche vous recevrez des idées sur l’analyse du jeu, l’entrainement ou encore l’apprentissage.
Qu’est-ce que le football représente pour vous ?
Pour moi, le football est avant tout un partenaire de vie. Enfant unique, c’est grâce à lui que je me suis fait des amis et que je n’ai pas été seul. Progressivement, cette relation s’est transformée en une véritable passion, imprégnant chaque instant de ma vie. Je n’ai pas le souvenir d’un moment où le football n’était pas présent, directement ou indirectement. C’est un peu comme un banquier qui enfile son costume chaque matin ; moi, j’enfile mon survêtement, car le foot, le sport, font partie intégrante de mon quotidien.
Ce lien aux autres, inhérent à l’activité, a d’ailleurs guidé mon parcours professionnel et mon engagement comme enseignant. J’ai toujours aimé partager. Avant le football, j’ai pratiqué le judo, et cette transition d’un sport individuel à un sport collectif m’a montré la richesse de ces différences.
L’envie d’encadrer les jeunes est venue très tôt. J’ai passé le BAFA, commencé à travailler avec des enfants, puis j’ai rapidement entraîné des équipes, notamment des seniors. C’est quelque chose qui est d’ailleurs arrivé trop tôt, en tant qu’entraîneur-joueur, et qui a été ma première expérience difficile. Néanmoins, j’ai continué, des plus petits aux plus grands, garçons et filles.
Comment vos parcours de joueur, d’entraîneur et universitaire se sont-ils articulés, et comment chacun a-t-il enrichi votre compréhension du football ?
Au départ, j’ai joué comme n’importe quel enfant, à partir de huit ans, l’âge minimum requis à l’époque. Notre accompagnateur, Gérard Le Goff, un bénévole exceptionnel, nous emmenait aux matchs en étant entassés dans sa voiture. En revanche, il ne connaissait rien au football. Nous étions vraiment en auto-formation : nous imitions ce que faisaient les plus grands sur le terrain et la qualité de jeu n’était vraiment pas terrible. L’essentiel, c’était le partage avec les copains et le plaisir de jouer.
À cette période, je n’allais pas beaucoup aux entraînements, d’autant qu’il n’y en avait pas beaucoup non plus. Je pratiquais aussi le judo en parallèle. Puis j’ai déménagé à Brétigny/O et mon père a d’abord insisté pour que je me concentre sur l’école, ce qui a entraîné une coupure de deux ans avec le football. J’ai continué le judo avant de pouvoir reprendre le foot en cadet, à Brétigny.
Là-bas, j’ai commencé à avoir des entraînements un peu plus structurés, même si les encadrants n’étaient pas forcément très formés. Pour eux, l’accent était mis sur la préparation physique : nous faisions beaucoup de tours de terrain et d’exercices d’endurance. Ensuite, nous passions directement à des situations de jeu assez complexes, à effectif complet, ce qui rendait les choses d’autant plus difficiles. C’était vraiment de l’auto-formation, dénommée plus tard « pédagogie des modèles auto-adaptatifs », sans réel accompagnement.
Le véritable tournant a eu lieu lorsque je suis entré à l’université, à l’UEREPS de Paris V, en 1976-1977. J’ai eu la chance d’être sur le site rue Lacretelle, près de la Porte de Versailles. Là, j’ai découvert une autre dimension grâce à mes enseignants. Parmi eux, il y avait René Deleplace, un des « premiers » théoriciens des sports collectifs de grand-terrain. A l’époque, l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) jouait un rôle majeur, et les responsables à l’UEREPS, des figures comme Daniel Bouthier et Serge Reitchess, étaient vraiment à la pointe d’un mouvement novateur, notamment inspiré par ce qui se faisait au rugby.
J’ai également eu la chance d’être encadré par deux personnages qui ont eu une influence très importante à cette période. Le premier a été Paul Filippi en football, qui était dans la droite ligne de ce qui se faisait avec René Deleplace. Ils étaient également fortement influencés par les travaux de Teodorescu et du colloque de Vichy, qui ont eu un impact majeur sur les sports collectifs à l’époque.
Le second est Gérard Fouquet, un professeur de judo qui était extraordinaire. Il pouvait nous présenter un thème et nous montrer à quel point tout était extraordinaire, puis le lendemain, revenir sur le même thème et nous démontrer que c’était totalement absurde. Cette capacité à nous montrer les deux facettes d’un même sujet était une préparation incroyable pour les écrits du CAPEPS.
En nous apprenant à réaliser cette prise de recul et à avoir une analyse critique, il voulait nous démontrer qu’il ne fallait pas tout accepter aveuglément. Sur le tatami, j’ai découvert la notion d’action-réaction-action typique des sports de combat, alors que mes apprentissages initiaux étaient basés sur la production de techniques pures. Un bouleversement total. Ma réussite au concours, je la dois à ma polyvalence (judo-foot) et à la rencontre de formateurs qui étaient de vrais scientifiques dans l’esprit d’une relation pratique/théorie, ou terrain/savoir.
C’est aussi à la fin des années 70 que j’ai découvert le « football total » avec l’Ajax Amsterdam de 1969-72, puis les Allemands du Bayern de 1973 à 1976. Il y a eu la Coupe du monde 1974 avec les Pays-Bas, puis la Coupe du monde 1978, malheureusement sans Cruyff. Durant cette Coupe du monde 74, nous avons assisté à quelque chose d’extraordinaire : les joueurs avaient une liberté qui n’existait pas auparavant, car les systèmes étaient très rigides. Soudain, les joueurs s’inscrivaient dans la dynamique des jeunes post-68, un mouvement qui, de France, à transpiré sur l’Europe. C’est dans ce contexte qu’est apparue cette équipe de l’Ajax Amsterdam avec ses joueurs aux cheveux longs, typiques de la période.
Ce qui était frappant avec l’Ajax, c’est que les joueurs avaient un poste de départ, mais sur le terrain, ils n’avaient pas de poste fixe. Un défenseur central pouvait monter et marquer un but de la tête, et Cruyff revenait défendre. Les joueurs évoluaient dans une symbiose complète et une intelligence de jeu remarquable. C’était peut-être une génération spontanée, comme nous en avons connu en France avec la génération Platini-Giresse, où les complémentarités mènent au succès, mais là, cette symbiose s’inscrivait dans la durée, avec des joueurs qui n’étaient pas forcément des génies techniques, mais qui, par leur intelligence collective, devenaient extrêmement performants. Le PSG a atteint cette compétence aujourd’hui avec des joueurs talentueux, mais au rythme des diverses compétitions, combien de temps cela va-t-il durer…
Le revers de la médaille est également apparu lors de la Coupe du monde 1974. Je pense qu’un certain manque d’humilité a coûté cher aux joueurs hollandais. Après avoir battu l’Allemagne au premier tour, ils se sont retrouvés en finale face à cette même équipe, pensant que la victoire était acquise. Ils marquent un but sur penalty après seulement 55 secondes et se voient déjà champions du monde, mais les Allemands, très solides, les ont finalement dominés. Je pense que s’ils avaient été un peu plus humbles, ils auraient gagné cette Coupe du Monde sans problème. Cela a fait apparaître une autre donnée à prendre en compte et que l’on constate aujourd’hui, c’est que la pression psychologique subie par les joueurs finit par les user, au même titre que la dépense énergétique nécessaire à la performance renouvelée.
Ce football était une révolution parce qu’il permettait aux joueurs de participer aux mouvements offensifs, même en étant des défenseurs. Chaque déplacement était pensé avec une intelligence de jeu et une complémentarité telles que le système n’était jamais perturbé par la liberté de mouvement des joueurs. Pour moi qui découvrait la partie d’intelligence de ce jeu, c’était extraordinaire.
A cette époque nous travaillions déjà avec Paul Filippi sur l’observation des matchs et l’analyse tactique. Nous avons été complètement immergés dans cette nouvelle approche, où des penseurs comme Ștefan Kovács affirmaient déjà que la technique devait être comprise dans le contexte du match, et non isolément. Ces idées s’inscrivaient dans la lignée de ce que Deleplace avait initié au rugby. Ce fut une véritable révolution pour moi en tant qu’étudiant. À partir de là, je me suis posé une question fondamentale : comment transmettre ces principes aux jeunes que j’allais encadrer ? Comment exploiter les différents savoirs qui interfèrent au cœur même de la pratique. Un défi permanent aujourd’hui encore…
Comment pouvais-je leur transmettre ces nouvelles approches du football, alors que, en tant que joueur, je n’avais jamais bénéficié d’un tel enseignement ? Donc assez rapidement, mon objectif a été d’aider les joueurs et joueuses. J’étais d’ailleurs un peu militant sur cette question des filles, notamment grâce à des amis dont les sœurs jouaient : pourquoi les filles ne pourraient-elles pas jouer au football ? Il y avait chez moi à la fois ce côté militant et l’envie de bien former les gens (1976-77).
C’est ce que nous sommes plus ou moins parvenus à faire avec les dirigeants et les filles du F.C. Juvisy. Nous avions un public très intéressant, ce qui a facilité les choses, car beaucoup d’entre elles étaient étudiantes en STAPS, à l’UEREPS. Elles étaient très à l’écoute. Avec Juvisy (de 1993 à 1997), nous avons atteint une très bonne qualité de jeu, ce qui nous a permis de remporter trois titres de championnes de France. S’il y avait eu, à l’époque, une Coupe de France puis une Coupe d’Europe, cela aurait été un repère très intéressant pour nous mesurer aux nations fortes de l’époque.
La première sélection nationale universitaire, que j’ai contribué à monter, et qui était encadrée par un professeur de l’UEREPS de Lacretelle, a également été un moment clé. Nous avons battu les Allemandes 1-0 et 3-1 chez elles. L’équipe comptait des joueuses de talent comme Brigitte Olive et Corinne Diacre, dont certaines évoluaient déjà au plus haut niveau national et international. Le fait remarquable est que nous avons réussi à battre l’Allemagne à une époque où l’équipe de France féminine ne rivalisait absolument pas.
Cela démontre que lorsque nous apportons des idées novatrices et que nous avons un groupe de joueurs ou de joueuses attentifs-ves, réceptifs-ves et qui s’investissent, nous pouvons parvenir à produire des choses qui ont du sens. Nous ne pouvons pas gagner systématiquement, c’est impossible. Mais nous pouvons créer des dynamiques intéressantes et, surtout, des expériences valorisantes pour les pratiquants et leurs environnements familiaux.
Ce succès s’explique par le fait que les joueuses ressentaient une réelle valorisation de leur travail. Elles percevaient l’intérêt de ce qu’elles faisaient et y prenaient un plaisir évident. Cet élan a renforcé la confiance qu’elles nous accordaient.
Cette première génération a été extraordinaire. Nous sommes vraiment parvenus à combiner la plasticité des joueuses – leur capacité à s’adapter – avec une rigueur certaine et une liberté de jeu simultanée. Pour nous, c’était l’apogée.
Parallèlement, durant les années 80, j’ai collaboré avec la commission technique de l’Essonne. J’entraînais alors à Palaiseau, un excellent club évoluant en Division d’Honneur (l’équivalent de l’actuelle R1), où nous avions des jeunes de très bon niveau. Cependant, nous ne parvenions pas à atteindre les championnats nationaux car, à l’époque, la qualification se jouait sur le « Maratrat », classement établi à partir des performances des pupilles, minimes et cadets du club.
Nous avons également observé une grande plasticité chez les joueurs, particulièrement en catégorie minime, où j’entraînais. C’est une période extraordinaire, propice aux transformations chez les jeunes, où nous pouvons accomplir des choses significatives. A cette époque, j’ai commencé à collaborer avec Daniel Charlot et Claude Doucet. Ensemble, nous avons conçu un appareil de statistiques pour le football (le MEMOBSER), un outil permettant de recueillir des données en match (Revue EPS de nov. 86). Nous imprimions les résultats via Minitel sur des bandeaux de papier, comme ceux des caisses enregistreuses de supermarché.
J’ai également collaboré avec Carlos Neves qui a développé un outil qui s’appelait BBSTAT plutôt orienté vers les enseignants d’EPS. Canal Plus s’est inspiré de ces travaux pour développer ses statistiques de match. Par la suite, j’ai aussi travaillé avec Michel Ebe, qui élaborait des statistiques pour la Fédération Française de Football et l’Équipe de France. J’ai aussi bénéficié de l’aide de Didier Braun et des membres du centre de documentation du CTNF, à l’époque de mon DEA.
Toutes ces expériences ont contribué à ma réflexion. Dans ma profession, nous avions une obsession : l’évaluation. Il fallait être objectif dans l’évaluation. Après avoir défini ce qu’est la performance en football, il fallait trouver comment évaluer objectivement une performance individuelle dans un sport collectif, ce qui n’est pas simple. Toutes ces questions se mélangeaient dans mon esprit, ce qui m’a poussé à chercher des bases solides pour une évaluation qui, bien que jamais totalement objective, s’en approchait le plus possible.
Vers 1985, j’ai fait la connaissance de Raul de la Fuente, un professeur chilien réfugié politique à la fac d’Orsay. C’est lui qui m’a un jour dit qu’un poste se libérait à la fac et que je devrais postuler. J’ai suivi son conseil, j’ai postulé et j’ai été pris. J’ai commencé au service des sports, qui était à l’époque intégré à la division STAPS. Progressivement, j’ai commencé à collaborer avec l’UEREPS. Puis, lorsqu’un poste s’est ouvert à Évry avec la création des STAPS Évry en 1997, j’ai postulé et j’ai été recruté. Le passage à l’université s’est donc fait de cette manière.
Dès mon premier passage à Orsay, entre 1989 et 1997, j’ai retrouvé des figures comme Daniel Bouthier et Bernard David, qui étaient spécialisés dans le rugby, ainsi que Gilles Ulhrich, que j’avais croisé lorsque j’étais étudiant. Nous étions alors pleinement engagés dans la didactique, ce qui nous valait d’être attaqué par d’autres courants. Même dans le milieu universitaire, les sciences de l’éducation et la didactique, qui étaient encore toutes fraîches, dérangeaient les sciences plus traditionnelles. Ce fut une véritable bataille pour obtenir un minimum de reconnaissance.
C’est dans cette dynamique de réflexion que j’ai repassé un DEA en 1996, pour valider mon Master 2, puisque le CAPES nous donnait l’équivalence d’un Master 1. Dans la continuité, Daniel Bouthier m’a orienté vers la recherche et m’a encouragé à faire une thèse. Cette thèse, en sciences de l’éducation, je l’ai réalisée à l’ENS Cachan. Au départ, Alain Durey devait être mon directeur de thèse, mais son décès m’a laissé un peu « orphelin ». C’est Jean-Francis Grehaigne qui a accepté de m’accompagner pour m’aider à la finaliser, d’où notre collaboration qui perdure encore aujourd’hui.
Ma thèse a été une véritable épopée. À l’époque, j’entraînais en club, j’avais mes cours à la fac et il fallait en plus avancer sur cette thèse. Ce fut un parcours assez particulier, un peu accidenté, mais aidé par les collègues j’ai finalement soutenu la thèse en 2005.
Le vécu de joueur (indépendamment du niveau de pratique) a souvent une influence importante dans la construction d’un entraîneur. Comment les apports théoriques ont enrichi votre propre expérience de pratiquant et votre développement en tant qu’entraineur ?
Pour aborder l’importance des apports théoriques, je vais d’abord revenir un peu dans le temps. Il faut reconnaître que Georges Boulogne a été à l’origine d’une certaine théorisation dans le football. En mettant en place les formations de cadres, son objectif était de leur faire acquérir des connaissances et des savoirs réutilisables. Cette structuration du football français a été d’une grande richesse, et c’est ce qui a permis à la France de se développer, même si nous avons dû attendre 1998 pour en voir les fruits.
Boulogne a structuré la formation des entraîneurs, la détection, et la formation des jeunes à travers des référentiels, afin que les clubs disposent d’éducateurs formés. Le problème, c’est que nous sommes passés à côté des savoirs scientifiques de l’époque, ou du moins de ceux qui sont arrivés progressivement après son action.
Un certain corporatisme s’est mis en place à ce moment-là, empêchant toute collaboration entre le monde fédéral et le monde universitaire. D’un côté, il y avait les professeurs d’EPS, avec leurs syndicats puissants qui défendaient la profession. De l’autre, Georges Boulogne qui avait compris l’importance de défendre la reconversion des anciens joueurs professionnels pour asseoir une certaine reconnaissance et son statut. Former les anciens joueurs était une démarche intelligente, mais ce rejet des ressources venues des universitaires a retardé l’accès à la performance. L’erreur qui existe toujours est de penser que seuls les pratiquants de haut niveau peuvent devenir des éducateurs ou entraîneurs de haut niveau. Malheureusement elle perdure dans les représentations sociales actuelles.
Le problème réside dans la séparation radicale entre la formation fédérale et ce qui venait des professeurs d’EPS. Alors que notre formation universitaire nous donnait accès aux nouveaux savoirs scientifiques, il y a eu un refus complet de les intégrer. Cela s’explique en partie par le fait que les anciens joueurs, à l’époque, n’avaient peut-être pas les outils ou le recul nécessaire pour se plonger dans le savoir universitaire. Puis de plus en plus, les joueurs ont suivi des études ou repris des études à la fin de leur carrière comme Rudi Garcia, par exemple, qui a suivi une formation universitaire à Orsay en parallèle des formations fédérales.
Ce rejet total de la collaboration avec le monde universitaire et les sciences nouvelles a été une erreur fondamentale. Aujourd’hui, chaque exemple de partenariat réussi entre universitaires et des personnes ayant une expérience de haut niveau dans le football démontre le contraire. De plus, le problème du football a été de cantonner les universitaires à la préparation physique, aux aspects médicaux ou à la préparation mentale, prétextant que les aspects tactiques étaient déjà maîtrisés par les joueurs.
Heureusement, les choses évoluent aujourd’hui. Beaucoup de cadres techniques de la Fédération ont désormais un parcours universitaire et ont pris ce recul nécessaire. Lorsque les moyens sont là, et que l’accès à ces savoirs est possible, les bénéfices sont évidents.
Pour en revenir à mon parcours, la rencontre des bonnes personnes, celles qui m’ont poussées à me poser les bonnes questions et qui m’ont fourni les outils pour trouver des réponses, des réponses jamais parfaites et toujours en évolution, a été fondamentale.
Il faut comprendre que le football ne consiste pas en seulement “taper dans la balle”. Si c’était le cas, la jonglerie se suffirait à elle-même. Le football, c’est quand l’esthétique du geste individuel vient compléter l’esthétique d’une action collective. Car la réussite dans un sport collectif dépend avant tout de l’action collective. Les journalistes évaluent souvent un but, en comparant une gestuelle individuelle extraordinaire, à une action collective où trois ou quatre joueurs enchaînent les touches de balle. Ce sont deux choses totalement différentes.
Lorsque nous parvenons à intégrer cette idée que le beau geste est un « plus », le côté artistique du jeu, mais que le football – et les sports collectifs en général – repose avant tout sur des actions collectives cohérentes et bien enchaînées, des actions individuelles qui s’articulent pour un résultat collectif, alors le plaisir prend une toute autre dimension. Le plaisir vient avec la qualité du jeu. Le spectateur, lui, trouve son plaisir dans la beauté de ces actions.
C’est à ce niveau qu’encore beaucoup d’équipes commettent une erreur. Sous la pression économique de la victoire à tout prix, elles finissent par jouer « tous derrière et un devant », en privilégiant l’idée de ne pas prendre de but. Pourtant, le football, c’est avant tout marquer des buts. C’est précisément ce que le FC Barcelone, avec l’arrivée de Johan Cruyff et en reprenant les principes du « football total », a su construire : une philosophie de jeu qui allie performance et spectacle. C’est un modèle difficile à maintenir sur la durée, car c’est aussi un football compliqué à mettre en œuvre.
Par ailleurs, certains pensent que le football d’il y a 40 ou 50 ans est dépassé, mais il ne faut pas jeter aux oubliettes ce qui a fait ses preuves ; il faut s’en servir. L’intelligence de jeu puise dans le patrimoine tactique existant depuis les origines du football. Toutes les évolutions successives se sont faites de manière logique, en fonction des contextes. Tout est bon, rien n’est à rejeter. Le Manchester City de Pep Guardiola, par exemple, a remporté la Ligue des Champions en étant initialement organisé en WM. Le WM, c’est un système de « vieux », dépassé, dit-on. Apparemment non… Tout est utilisable. Il faut simplement savoir s’adapter à l’adversaire et José Mourinho en a donné la preuve en étant performant sans penser au plaisir procuré.
Le gros défaut que nous avons en France, et que je constate encore aujourd’hui dans le contexte des clubs où j’évolue, c’est cette tendance à copier le haut niveau. Il y a 30 ou 40 ans, pourquoi pas. Mais copier le haut niveau aujourd’hui, avec les différences d’entraînement, la qualité et la quantité des séances, et les aspects spécifiques au football professionnel, c’est une erreur quand on l’applique au monde amateur. Même si les joueurs amateurs actuels sont techniquement meilleurs qu’avant, mieux préparés physiquement, ils sont paradoxalement souvent en manque de connaissances tactiques et stratégiques.
Cela démontre qu’il existe des lacunes essentielles pour la maturation des joueurs vers une cohérence de la pratique. C’est très gênant car, précisément, nous ne leur apportons pas les données théoriques essentielles. Si un joueur ne comprend pas pourquoi il fait quelque chose, il sera difficile d’être efficace à onze. Nous nous sommes longtemps concentrés sur des entraînements isolés, avec le ballon, sans prendre en compte l’adversaire. Il était temps de réaliser que nous jouons contre des adversaires.
La question devient alors : comment mettre en place des situations d’entraînement ou des situations pédagogiques qui donnent un avantage particulier aux défenseurs pour limiter l’attaquant, ou, à l’inverse, qui favorisent l’action de l’attaquant ? Cela relève de la didactique. Cela exige une réflexion approfondie et une évaluation précise du niveau de nos joueurs. Il s’agit de les placer dans le bon degré de difficulté dans leur processus d’apprentissage, afin qu’ils intègrent des données théoriques et une compréhension du jeu qui leur permettront, au cœur de l’action, de reproduire les bons gestes ou de faire les bons choix tactiques pour être efficaces. Tout cela avec un temps d’intervention qui est parfois réduit à un ou deux entraînements par semaine.
Le bon choix tactique est la priorité absolue. Bien sûr, je ne jette pas la gestuelle à la poubelle ; elle est essentielle. Si vous réfléchissez bien mais que vous ratez toujours votre geste, cela ne fonctionnera pas non plus. Mais c’est toujours l’intention qui commande le geste.
Tant que nous ne travaillons pas sur cette intelligence de compréhension du rapport d’opposition – pour favoriser ou faciliter le choix sous la pression temporelle – nous n’aidons pas nos joueurs à être efficaces. Il ne faut pas s’étonner si, encore aujourd’hui, le pourcentage de possession menant à un but est si faible : 1 % ou 1,5 % en général (CM 98), sauf pour les grandes équipes. Sachant qu’il y a toujours un risque de prendre un but sur un fait de jeu (une glissade, un faux rebond, un ballon contré), la marge est infime.
Donc s’appuyer sur des outils comme les statistiques et la vidéo, c’est bien, mais la question clé est : comment les utiliser ? Comment exploiter les données d’aujourd’hui ? Le problème, c’est que tout le monde n’a pas cette réflexion. Pourquoi ? Parce que cela demande un travail d’observation essentiel, ainsi qu’un choix rigoureux des critères d’observation en fonction de la thématique à aborder et des problèmes rencontrés.
Ensuite, toute cette intelligence, toutes ces données théoriques que nous apportons aux joueurs, doivent être partagées. Elles doivent être partagées entre l’entraîneur et les joueurs, et entre les joueurs eux-mêmes. Pour cela, il est impératif d’avoir des termes qui ont du sens, un langage commun et cohérent.
Si nous n’avons pas cette étape de la conceptualisation, dont nous parlions précédemment, la confusion est inévitable. Il est déjà complexe de faire fonctionner une équipe, mais si, en plus, nous n’utilisons pas les mêmes mots et que les joueurs n’ont pas les mêmes codes pour les comprendre, c’est impossible.
Cependant, pour qu’un entraîneur soit bon, il ne suffit pas qu’il ait été un ancien joueur, même si cela apporte des choses. Il ne suffit pas non plus qu’il ait de solides connaissances théoriques. Il doit avant tout être un observateur aiguisé de ce qui se passe sur le terrain. Beaucoup d’entraîneurs n’ont pas les outils d’observation et d’analyse du jeu nécessaires pour apporter des éléments pertinents qui permettront à l’équipe de progresser. C’est une somme de petits détails.
L’entraîneur doit prendre du recul et également avoir cette volonté permanente d’améliorer son intervention. Il doit se dire : « Quelle situation puis-je mettre en place pour que mes joueurs comprennent les idées et choix réalisés ? ». C’est un processus toujours très long, car les joueurs arrivent avec leurs propres apprentissages. Mais le plus important, c’est d’arriver à ce que les joueurs adoptent ce langage commun et transforment leurs acquis antérieurs.
C’est très difficile. Nous sommes obligés de passer par une période de jeu un peu stéréotypé, un peu comme ce que faisaient les pays d’Europe de l’Est. Ce type d’approche permet d’établir une base de construction du jeu, qui permettra ensuite de libérer la créativité de chacun.
C’est là que nous atteignons l’épanouissement complet de chaque joueur et de l’équipe. Cela ne signifie pas que nous allons tout gagner, car les adversaires ne sont pas stupides et les rapports de force sont rarement équilibrés. C’est d’ailleurs pour cela que c’est si intense émotionnellement de battre une équipe plus forte que soi. Mais ce n’est également pas facile de gagner même lorsqu’on est plus fort, comme on peut le constater chaque année en Coupe de France. Il est encore moins facile de continuer à gagner après les premières victoires.
Le football est un jeu aux multiples facettes et il faut gérer une multitude d’éléments : les joueurs, le fonctionnement du groupe, les choix de sélection, les binômes, les trinômes qui fonctionnent, etc. Il y a aussi les défis liés à la personnalité des joueurs : que faire de celui qui, malgré ses grandes qualités, ne comprend pas ce que nous cherchons à lui apporter ? Va-t-il jouer le jeu, ou va-t-il faire la tête sur le banc et semer la discorde dans le vestiaire ? C’est toute cette complexité qui rend ce défi extraordinaire.
Justement, comment approcher l’apprentissage du football afin d’aider les joueurs à “transformer leurs acquis antérieurs” et adopter un “langage commun” pour coopérer ?
Le football commence désormais à 5 ou 6 ans, alors qu’avant, il débutait à 8 ans. À 8 ans, le processus de socialisation est déjà en place ; à 6 ans, il se construit en élargissant le réseau. Nous devons donc nous appuyer sur les travaux de Jean Piaget, notamment la notion de réversibilité, que nous avons déjà abordée dans un précédent article.
Cela complexifie notre approche du football. Nous demandons à un enfant qui n’est pas encore mature, qui est dans ses apprentissages initiaux, de développer des gestes techniques tout en le confrontant déjà à un rapport d’opposition. Il doit comprendre les effets de cette réversibilité et commencer à collaborer. Pour cela, il faut remettre en place des situations pédagogiques simplifiées pour que les éducateurs puissent travailler efficacement.
Il faut donc revenir à l’infra-système, en référence aux travaux de Jean-Francis Gréhaigne que j’ai repris sur l’infra-système, le micro-système, le méso-système et le macro-système. Pour les plus jeunes, il faut donc concevoir des exercices de coordination motrice qui intègrent déjà la gestuelle du football et introduisent des aspects tactiques dans le rapport à l’adversaire. Il est important de mettre en place des situations de relation avec un partenaire face à un adversaire. Cette réflexion sur les très jeunes est encore trop peu développée.
Les plus jeunes on fait du 5 contre 5, avant de revenir aujourd’hui au 3 contre 3 ou 4 contre 4 avec un gardien. Le 3 contre 3, c’est ce que nous faisions déjà avec les professeurs d’EPS il y a 40 ans… Cela a mis 40 ans à s’imposer, et c’est dommage. Si nous avions accepté ces méthodes à l’époque, nous serions certainement plus efficaces aujourd’hui. Sachant que la France, grâce à sa structuration, est déjà l’un des meilleurs pays au monde, nous pourrions être encore plus performants.
Ensuite, nous passons au microsystème, où nous introduisons les « unités tactiques isolables », concept cher à René Deleplace et à Daniel Bouthier. Puis à « l’espace de jeu effectif » (EJE, Gréhaigne) avec ces différents niveaux, pour poursuivre avec la « cellule de l’action de pointe », etc… On insiste sur le jeu à effectifs réduits, avec l’exemple typique du futsal en 4 contre 4 avec gardien. Le futsal, originaire d’Uruguay, apporte toutes les bases nécessaires, comme en témoigne le jeu des Portugais et des Espagnols.
Quand nous observons l’équipe d’Espagne, elle s’appuie sur une structuration à base de losanges. Il n’est pas surprenant que tout nouveau joueur qui intègre le groupe se trouve rapidement avec ses partenaires. Toute cette progression du méso-système (une partie des joueurs), vers le macro-système (la totalité de l’équipe), en passant du football à 5 contre 5, au 8 contre 8, pour finir au 11 contre 11, est essentielle. J’avais d’ailleurs proposé le 8 contre 8 dès 2007 dans mon ouvrage Enseigner le football: En milieu scolaire (collèges, lycées) et au club, car c’était clairement plus pertinent que la progression existante à l’époque : 5c5, 7c7, 9c9, 11c11.
À partir de là, une structuration se met progressivement en place, et nous donnons aux joueurs des outils de conceptualisation du jeu au fur et à mesure. Normalement, à la fin de l’adolescence, un joueur est outillé pour développer une certaine plasticité dans son jeu. Mais tout cela ne peut se construire que grâce à une approche didactique adaptée.
Ce n’est pas en faisant travailler quelqu’un avec un ballon seul que nous lui ferons comprendre toutes les relations qui se construisent avec les partenaires. Cela a été une grosse erreur de ne pas intégrer très rapidement le rapport à l’adversaire dans les apprentissages moteurs, car celui -ci se construit en fonction du rapport d’opposition. Nous savons très bien que la vitesse du joueur, sa latéralité (gaucher ou droitier), ou sa capacité à utiliser les deux pieds, changent complètement la donne. Tout cela amène une diversité complémentaire qui crée des obstacles et de la richesse en compétition.
En préambule de votre travail de thèse nommé Approche technologique de la récupération du ballon lors de la phase défensive en football, contribution à l’élaboration de contenus de formation innovants, vous avez inclut la citation suivante : “L’enseignement d’un jeu sportif collectif ne peut être réduit à un apprentissage (par imitation et répétition) d’une gamme de gestes techniques, comme une « série de réponses » correspondant à une série de « situations problèmes ». C’est la perspective d’acquérir une attitude de décision permettant au joueur d’opérer un choix pour agir dans une situation déterminée, entre autres, par les paramètres suivants : la situation topographique du ballon dans l’espace proche, les éléments corporels intervenant sur le ballon, les distances avec les autres joueurs (partenaires, adversaires). » (Méot, Plumereau, 1979, p. 59). Que vous évoque ce texte au regard du travail que vous avez produit ?
Cette citation est fondamentale, même si elle date un peu, car elle remet en question la vision réductrice de l’enseignement sportif par la seule imitation et répétition. Revenons un peu en arrière. Après les Jeux Olympiques de Rome (1960), les piètres résultats de la France ont conduit à intégrer le sport dans l’Éducation Physique et Sportive (EPS). C’est alors que des chercheurs ont commencé à travailler sur la distinction des habiletés. Leur constat était simple : nous ne pouvons pas enseigner de la même manière à un gymnaste, un skieur, un combattant (sport d’opposition) ou un joueur de sport collectif, où l’opposition se mêle à la collaboration.
À l’époque, nous étions encore très ancrés dans l’imitation du geste du champion. L’idée était de copier le geste de l’athlète performant. Or, copier un geste dans un sport collectif sans tenir compte de l’environnement n’est pas suffisant. C’est là qu’est née la distinction entre les habiletés ouvertes, semi-ouvertes, fermées et semi-fermées. C’est une base essentielle qui nous dit : « Je ne travaille pas de la même façon selon le type d’habileté sur lequel je me concentre. »
Cette base est primordiale. J’ai eu l’occasion de discuter avec un responsable de l’équipe de France de ski lors d’un colloque à l’INSEP. Il expliquait que la technique dans les différentes épreuves, bien sûr, s’adapte aux potentiels physiques de chaque individu, à sa puissance, ou à son poids en descente – plus lourd, plus rapide. Tous ces éléments morphologiques et biologiques entrent en ligne de compte. Mais il ajoutait : « Quand un skieur passe à midi sous le soleil et qu’un autre passe une heure après à l’ombre, la neige n’est pas la même. La trace a été faite par dix ou vingt skieurs avant, donc on ne skie pas de la même façon. » C’est là une habileté semi-fermée. Dans un slalom, vous êtes seul, personne ne vous gêne, mais les conditions ne sont pas figées, il y a une adaptation technique nécessaire face à un environnement qui change.
En gymnastique, quand vous êtes dans une salle avec votre barre, vous gérez l’écartement des barres asymétriques ou parallèles selon votre personnalité. Mais vous évoluez dans un contexte sans influence extérieure, seul face à votre agrès.
Personne n’essaie de casser la figure au gymnaste qui fait ses exercices aux barres. La confrontation aux autres est indirecte. Comme en athlétisme en dehors des courses à partir du demi-fond. A contrario, un boxeur qui s’entraîne face à différents sacs de frappe en répétant les coups n’est pas dans les bonnes conditions. Quand il monte sur le ring, il y a un adversaire qui va bouger et essayer de le toucher et de le mettre en difficulté. Cela nous renvoie à l’action qui provoque une action pour ouvrir une autre possibilité d’agir et d’atteindre l’objectif.
C’est une logique similaire au judo. Un judoka s’entraîne physiquement pour un combat de trois ou quatre minutes. Il fait des séquences de trois minutes pour tenir la durée. Prendre le kimono de l’adversaire, sentir les bras chauffer, faire un certain nombre de tentatives de prises en une minute, c’est coûteux. Le combat sera-t-il acharné, avec l’adversaire qui vous presse constamment, ou y aura-t-il des pauses ? Ce sont des différences fondamentales, notamment en termes de dépense énergétique. Chaque combat est unique.
Quand un adversaire vous plie en deux, si à un moment donné vous n’êtes pas capable de vous échapper, de réagir, ou de profiter d’une petite faille pour revenir à la philosophie de Jigoro Kano – penser d’abord au déséquilibre – vous ne gagnerez pas votre combat sauf accident pour l’adversaire. Cela signifie que, dans les rapports d’opposition, quelque chose se construit. Nous ne sommes pas dans la tête de l’autre, mais nous devons faire comme si nous l’étions. Si, dans votre préparation au combat, vous n’intégrez pas cela, il vous manquera quelque chose, c’est inévitable.
Par conséquent, dans un sport collectif, si vous n’intégrez pas le rapport à l’opposition et la notion de coopération, ainsi que les outils pour bien coopérer – c’est-à-dire des concepts et des mots qui ont du sens – vous ne pouvez pas réussir.
C’est essentiel. Si nous ne plaçons pas les joueurs le plus possible dans les conditions qu’ils vont rencontrer en match, tout en tenant compte de leurs capacités actuelles, cela ne peut pas marcher. C’est là que réside toute la complexité : savoir les observer pour comprendre où ils en sont et mettre en place les étapes nécessaires à leur progression.
Cependant, nous pouvons faire toute cette démarche, mais si le joueur s’en moque et ne veut pas coopérer, ça ne fonctionnera pas. Dans tous les sports, s’il n’y a pas une coopération de sa part envers l’entraîneur, c’est impossible. C’est pourquoi il faut distinguer l’intelligence de jeu, l’intelligence du jeu et l’intelligence du joueur. Si le joueur ne veut pas participer à son propre processus d’apprentissage, nous n’y arriverons pas, quelles que soient nos compétences.
C’est également une citation qui renvoie aux travaux de thèse de Daniel Bouthier sur les aspects décisionnels dans la formations d’actions sportives collectives, guidé par les travaux scientifiques de Jacques Leplat et Alain Savoyant sur une base de psychologie cognitive. Dans un match, une multitude d’informations nous parviennent en permanence, y compris des informations proprioceptives. Nous avons cet objet, le ballon, à gérer au milieu de tout cela. Il faut donc développer une multitude de compétences pour que la décision soit prise le plus rapidement possible, car le laps de temps est très réduit. Plus nous montons en niveau, plus le jeu s’accélère, et plus nous sommes contraints de prendre ces décisions dans un délai court.
Nous entrons alors dans des routines. Je n’aime pas trop le terme automatisme, car les situations ne sont jamais systématiquement identiques, ce n’est pas du copier-coller. L’automatisme ne dure pas. Nous sommes en permanence dans des processus d’adaptation.
Ces rapports à la décision sont essentiels, car ils conditionnent le geste que nous allons faire. Notre geste est toujours commandé par notre cerveau. Aujourd’hui, il y a une utilisation abusive de certains termes. Quand une personne réagit, on parle de réflexe. Mais ce n’est pas un réflexe, puisque l’arc réflexe ne passe pas par le cerveau, mais par la moelle épinière. C’est une réaction, ce qui signifie que ce n’est pas inné, c’est acquis et donc appris.
Il y a de nombreuses incohérences dans l’utilisation quotidienne de termes comme « réflexe » ou « automatisme ». On parle de joueur « doué », de talent « inné ». Mais comment le football pourrait-il être inné alors que nous apprenons à marcher ? Si nous n’apprenons pas à marcher, nous ne pourrons jamais jouer au football. Cela illustre bien le problème de la conceptualisation : des mots sont utilisés à tort et à travers. Certes, une réaction rapide d’un gardien peut s’apparenter à un réflexe par sa vitesse, mais ce n’en est pas un.
Quand un gardien de but intervient, il ne s’agit pas d’un réflexe. Il y a un signal qui est monté au cerveau, une prise de décision, puis un geste effectué en fonction d’une prise d’information sur un objet mouvant qui se déplace à une certaine vitesse et dans une direction donnée. Ce n’est donc pas un réflexe.
Il y a beaucoup d’autres exemples similaires. Quand des formateurs souhaitent transmettre des outils cohérents à leurs élèves, étudiants, quel que soit leur niveau, il est essentiel d’avoir un minimum d’outils, de connaissances et de savoir pour aller dans la bonne direction. C’est la seule façon d’aider concrètement les individus à progresser.
Les aspects défensifs sont au cœur de vos travaux. Alors, pour vous, quels sont les éléments qui composent le concept “défendre” ?
Pour moi, le concept de défendre, c’est d’abord protéger sa cible, ne pas prendre de but. Mais c’est aussi et surtout récupérer le ballon. C’est pourquoi, dans mon travail sur le tacle, le geste n’était efficace que s’il entraînait la récupération du ballon. Jean-François Jodar, lui, intégrait également la notion de destruction du jeu adverse. Nous avons là deux approches complémentaires mais différentes dans les effets attendus et donc le mode d’engagement dans l’action.
La phase de mise en place défensive est avant tout une phase de protection en vue de la récupération. Le pressing, et le sur-pressing que l’on observe aujourd’hui, est une volonté agressive de récupérer le ballon. Pourtant, quand nous voyons les difficultés rencontrées par un certain nombre d’équipes de très haut niveau pour réaliser cela efficacement, alors que les joueurs s’entraînent tous les jours, cela montre la difficulté. On pourrait aborder aussi les conséquences au niveau de la dépense énergétique avec le nombre de matches en hausse pour les meilleures équipes.
Alors, quand je vois que dans certains clubs amateurs, on voudrait mettre en place un pressing intense, je me dis : « Mais attendez, vous avez deux entraînements par semaine, avec des joueurs qui ont très peu de connaissances, une préparation physique aléatoire, et vous voulez déjà mettre en place un pressing ? » Nous sommes obligés de nous inspirer du haut niveau, mais avons-nous les moyens, avec la base de connaissances de nos joueurs, de coordonner un pressing aussi performant que celui de Liverpool ? Pour moi, la réponse est non.
L’idée, c’est d’abord de placer un obstacle entre l’adversaire et nous, c’est-à-dire de bien se replacer. Toutes les formes de pressing qui se construisent après sont destinées à des équipes plus fortes, qui ont le temps de travailler ces aspects.
Ensuite, la volonté est de récupérer le ballon dans certaines conditions, dans la continuité du jeu. Pourquoi ? Parce que lorsque nous récupérons le ballon dans la continuité du jeu, nous avons plus de chances de marquer. L’adversaire n’a pas eu le temps de se réorganiser. C’est pour cela que dans ma thèse, j’ai différencié les phases statiques, où l’adversaire a le temps de se repositionner. Là, nous sommes contraints temporellement, et nous repassons sur une attaque placée. Il est donc crucial de fournir aux joueurs les outils nécessaires et de travailler sur l’organisation collective.
Votre thèse met en lumière que l’action défensive commence bien avant la perte de balle. Comment avez-vous modélisé ce processus pour le rendre concret et transmissible aux joueurs ?
Dans la continuité de mon travail de DEA sur le tacle, je ne voulais plus que les joueurs se jettent, car ce n’était manifestement pas efficace. Je leur disais donc : ne te jette pas. C’est d’ailleurs quelque chose que je dis encore, mais ce qui est fondamental, c’est quelles solutions donnons-nous aux joueurs ? Que doivent-ils faire s’ils ne se jettent pas ?
Donc par la suite, dans ma thèse, j’ai voulu identifier les zones qui favorisent la récupération du ballon. L’enjeu était d’apporter des connaissances à mes joueurs pour qu’ils aient un comportement pertinent en fonction de leur position sur le terrain.
Je me suis aperçu, par exemple, que la plupart des récupérations de balle chez l’adversaire se font sur les ailes. Il faut donc amener l’adversaire vers les côtés, en bloquant l’intérieur, car lorsqu’il est obligé de dégager, il va souvent mettre le ballon en touche. Si nous lui laissons l’intérieur, nous nous retrouvons en infériorité numérique et il peut construire son jeu, ce qui nous mettrait en difficulté. Il faut donc lui bloquer l’intérieur et le guider vers la périphérie.
Quand le jeu arrive dans notre propre moitié de terrain, nous récupérons beaucoup de ballons hauts dans l’axe. Pourquoi ? Parce que lorsque les adversaires tentent un jeu long, ou dégage tout simplement nous avons une supériorité numérique dans l’axe. C’est dans la zone avant notre surface de réparation que beaucoup de ballons sont récupérés. Si nous les laissons passer là, ils entrent dans un entonnoir, et nous risquons de prendre des buts. L’intérêt est alors de reconstituer notre point fort et de les amener vers la périphérie pour les bloquer avec les lignes de touche. Quand un joueur adverse est acculé à la ligne de fond ou à la ligne de touche, il ne peut que reculer. Plutôt que de chercher à prendre le ballon et risquer d’être éliminé, ce qui créerait un déséquilibre collectif, nous continuons à orienter le jeu de l’adversaire vers les ailes, sans chercher à intercepter le ballon.
Donc, premièrement, nous sortons l’adversaire de l’entonnoir, le privant ainsi d’angles de frappe. Deuxièmement, nous créons une supériorité numérique fictive en nous appuyant sur les lignes qui délimitent le terrain. A partir de ces connaissances, nous mettons en place des situations pédagogiques qui visent à développer chez nos joueurs ce type de comportement, notamment une fermeture et un positionnement du corps qui dirigent l’adversaire vers les lignes de touche.
Mon travail de DEA, basé sur l’analyse de matchs de la Coupe du Monde, avait révélé que 30 % des buts étaient marqués suite à un tacle raté, qui peut aussi entraîner un coup franc ou un penalty, sans compter le nombre de sanctions (avertissements, expulsions). A haut niveau, on ne peut pas accepter un tel taux d’échec.
Aujourd’hui, les professionnels le reconnaissent et sont nombreux à défendre en recul frein. À l’époque, c’était plutôt « je te rentre dedans et on verra ensuite ». Non, c’est reculer, freiner, orienter l’adversaire et l’amener sur les côtés. Bien repositionnés et en supériorité numérique la tâche des adversaires se trouvent complexifiée.
Tant que le terrain et les rapports d’opposition ne changeront pas, ces principes resteront pertinents. C’est la même chose au rugby : en cas de jeu déployé les joueurs commencent et effectuent un glissement défensif vers les extérieurs pour déplacer les points d’impact. Plutôt que d’attaquer « en tête de bêche », pour empêcher les adversaires d’utiliser toute la largeur, ils mettent en place une défense glissante pour coller l’adversaire à la ligne. Au basket, quand un joueur est en un contre un, il va orienter son adversaire sur le côté. Sur un angle fermé, il est plus difficile d’atteindre le panier que lorsque vous êtes face à lui, même si l’utilisation du panneau est moins fréquente aujourd’hui. Au basket, les angles sont ouverts à plus de 180 degrés, ce n’est pas la même chose. Mais au football, un but comme celui de Van Basten en Coupe d’Europe (1988), marqué d’un angle fermé au deuxième poteau, est statistiquement très rare.
Ces constats doivent être réutilisés dans la formation, en proposant des situations pertinentes.
Qu’est-ce que toutes ces expériences, ces recherches, ces rencontres, vous ont appris sur le plan humain et sur celui de l’apprentissage ?
Sur la nature humaine, c’est comme la question de l’intellectualisation du football : c’est un vaste sujet. Ce que nous pouvons dire, c’est que les gens sont le fruit de leur histoire, et qu’ils agissent en fonction de leurs problématiques et de leurs motivations. Nous pouvons donc observer tous types de comportements, d’autant plus dans les interactions relationnelles.
Il est donc très difficile de rester figé sur une idée. L’être humain est complexe. Pour moi, la question fondamentale c’est : que pourrions-nous faire pour qu’il y ait une forme d’égalité intellectuelle, d’égalité, d’équité, dans le respect des gens, de prise en compte des caractéristiques individuelles de chacun, sans que cela ne débouche sur des situations de conflit ?
C’est ce qui est intéressant avec l’université. Cela vous pousse à vous défaire de vos certitudes. Vous ne restez plus figé sur des idées préconçues. Vous essayez d’avoir une analyse plus objective, même si elle ne l’est jamais totalement, car nous sommes tous le fruit de notre expérience et de notre histoire. Cela permet de prendre ce recul, même s’il y a également des gens bornés qui défendent leurs propres intérêts à l’université et qu’il y a des luttes de pouvoir.
Mon parcours m’a également enseigné ceci : j’ai joué au football pendant des années sans recevoir d’explications claires. Le jour où j’ai commencé à comprendre la richesse de cette activité – ses apports aux apprentissages moteurs, au développement de l’intelligence et à la coopération – je me suis posé une question essentielle : comment mieux l’enseigner ? Comment puis-je, à mon tour, former des gens et leur apporter ce que d’autres n’ont pas pu me donner, faute d’outils ?
Ma quête, mon Graal, c’est de trouver en permanence les outils, au fil de mes expériences et de mes échanges. Comment puis-je améliorer mes situations pédagogiques pour favoriser l’apprentissage ? C’est ma raison d’être. Quelle que soit la personne en face de moi, quel que soit son niveau – homme ou femme, fort ou faible – peu importe. Mon objectif est de lui permettre de s’améliorer, de s’épanouir et de grandir. C’est ça ma quête, avec le football en toile de fond.
Rejoignez + de 4500 passionnés en vous abonnant à notre newsletter et recevez nos entretiens, directement par e-mail.

















